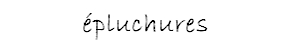Nous ne faisons pas de l’art comme un pommier fait ses pommes dans le vent et la lumière du printemps, mais comme des prisonniers qui nouent des draps pour s’évader. (1157)
Voilà. Je suis arrivée au bout des deux tomes des éditions Omnibus. Je m’attristais par avance d’avoir fait le tour des romans de Jean Carrière, mais je vois qu’il m’en reste encore trois qui ne figurent pas dans ces recueils. Le grand vide ne sera donc pas pour demain… ouf…
Il y a un état d’esprit à la fois progressivement érudit et addictif qui naît de la dévoration de l’œuvre complète d’un écrivain (accompli). Une familiarité émouvante qui se crée. On connaît les pistes, les tics, la forme de ses pas dans le sable de l’écriture, ses obsessions… Si la lecture y perd en surprise, elle y gagne en perspicacité.
Jean aura été – sera encore – un ami des lettres précieux. Et comme je vais souvent au cœur de ses paysages, montagnes et vents, causses et froidures, je ne suis pas prête de perdre le lien. Une même quête, un même sentiment étourdissant de l’existence m’habite et en habitera d’autres, qui de la littérature tirent une sève parfois âpre mais incomparable.
Ce sont souvent les livres écrits pour soi, dans la solitude et la désespérance, qui touchent le plus les autres. Ce paysage paisible et doré qui entoure Jean Carrière, et qu’il ne peut plus voir ailleurs que dans sa mémoire blessée, ses lecteurs le regardent désormais pour lui, dans ses livres, au bon goût de terre sèche, avec reconnaissance. (Jérôme Garcin V)
Les Français vont devoir passer par où les chats s’étranglent pour connaître la valeur de la démocratie. (73)
Puisque notre passé se situe non pas derrière nous, perdu au-delà des temps, mais devant nous, dans un présent à venir où nous avons la seule possibilité de l’atteindre à travers nos sens restaurés, un cœur remis à neuf et disposé à se battre pour la vie. (137)
Faulkner me rendait fou. J’ai lu et relu je ne sais combien de fois « Le Bruit et la fureur », « Lumière d’août », « Absalon ! Absalon ! », « Tandis que j’agonise ». Bataille contre le temps d’une sauvagerie inouïe. Proust, aussi sympathique qu’il me parût, me laissait sur ma faim. En fait, j’avais besoin que le sang coule. Chez Proust, c’était plutôt le thé qui coulait, et les mondanités d’un snob ne faisaient pas le poids devant les hurlements de l’idiot Benjie à qui je finirais par ressembler. (241)
Si je suis fou, je le suis comme Dieu est fou : je n’ai aucune espèce de considération pour le convenu. Et je prétends que tout ce qui est convenu a pour mission de dissimuler ce qu’il y a de fondamental dans la vie. (277)