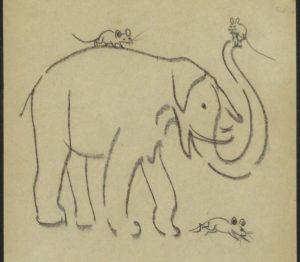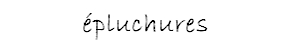Massif de l’Aigoual, sources de la Dourbie
Si le jardin a pu être le lieu où contempler les métamorphoses et l’impermanence, maintenant l’accélération du courant m’impose la conscience de m’y trouver moi-même immergée. Je ne suis plus un observateur extérieur, venu disposer et administrer. Je suis moi-même soumise à une force. D’où un sentiment de fraternité vis-à-vis du jardin, une sensation plus aiguisée d’en faire partie. D’être tout aussi sans défense, tout aussi mortelle. (22)
Je suis en train de me noyer lentement et personne ne peut me lancer la bouée de sauvetage. (233)
Ce journal est à la fois profondément émouvant et porteur d’une grande fraternité de cœur. Pia Pera, bien qu’entourée d’aides et d’amis, vit ses expériences dans la solitude de son être. L’incertitude concernant la nature de sa maladie, l’angoisse sur son issue, avec lesquelles elle est obligée de cohabiter, la poussent à se tourner vers divers médecins, charlatans et guérisseurs alternatifs, non sans humour et recul après coup, mais la véritable voie qu’elle trace est au fond d’elle-même. Et elle nous l’offre, à travers ce livre destiné dès le début à des fins de publications. Elle aurait souhaité être encore là quand nous le tiendrions entre nos mains, évidemment, mais cela n’a finalement pas été le cas.
Je finis le livre de Marinella (…). Une chose me frappe : elle a perdu, écrit-elle, tous ses muscles volontaires et elle vivra seulement aussi longtemps que fonctionnera l’unique muscle involontaire, le cœur. N’est-elle pas étrange, cette maladie extirpant, petit à petit, tous les mouvements dus à notre propre volonté ? (142)
Atteinte d’une maladie du moto-neurone, elle perd peu à peu son autonomie physique, les muscles ne répondent plus, les membres restent inertes, la vitalité est contrariée. Elle s’insère peu à peu dans la communauté des stagiaires de la mort pleinement conscients de leur dégradation progressive. Seul l’esprit reste vif, dynamique, créatif. Pia Pera tente de rassembler ses énergies, de trouver une harmonie intérieure, un équilibre, de se penser autrement qu’en personne malade, d’avoir le talent d’accueillir encore la vie présente, cette unique fenêtre sur le monde, fût-elle réduite à la taille d’une meurtrière, d’un trou de serrure.
Plongée dans l’instant présent, comme cela ne m’était encore jamais arrivé, je fais enfin partie du jardin, de ce monde fluctuant en perpétuelle transformation. (24)
(…) je me sens, maintenant plus que jamais, en rapport intérieur avec une espèce de beauté et d’harmonie impalpables. Cette beauté continue à se révéler à mesure que l’approche de la mort fait disparaître la complaisance du moi, l’attachement au monde. Je me sens réabsorbée au-dedans d’une entité plus vaste que moi. (29)
Pia Pera ne fuit pas. Elle contemple. Elle tâtonne. Apprivoise la mort à travers la pulsation de son jardin. L’effondrement de tout ce à quoi elle a cru, la perte de ce qui lui était cher et structurant sont très douloureux, la dernière partie est poignante, mais elle se tourne de plus en plus résolument et avec courage vers son dernier refuge intérieur, se résout à sortir finalement du déroulement narratif. De son travail de dépouillement lucide naissent des intuitions inspirantes et une grande beauté.
Peut-être, à l’approche de la mort, le jardinier n’est-il plus jardinier. L’écrivain n’est-il plus écrivain. Peut-être, à l’approche de la mort, voit-on arriver la conscience d’être en réalité indéfinis. C’est cette nature indéfinie qu’on apprend à accepter par la méditation. (210)
Le legs de ce témoignage, qui touche à notre expérience commune de l’existence, est un geste précieux. Reste cette question, la seule finalement essentielle : que se passe-t-il au niveau de la conscience quand la dernière expiration s’éteint sans qu’aucune inspiration ne la suive ?
[Lu dans le cadre de ces fabuleuses masses critiques]

Massif de l’Aigoual – Maison forestière

Massif de l’Aigoual

Massif de l’Aigoual – Sources de la Dourbie

Massif de l’Aigoual
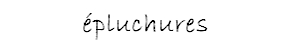
Moi je ne suis allée qu’une ou deux fois à l’église locale, leur ai-je dit, pour des occasions bien précises – commémoration d’un défunt, mariage – et chaque fois j’ai éprouvé une véritable rage face à l’occasion perdue. Par la médiocrité de ses propos, le prêtre détruit l’unique occasion offerte à la majorité des gens de se confronter à quelque chose de transcendant, de spirituel. (62)
Des stages de suicide, dirigés par le docteur Philip Nitschke. (…) Le public visé par ces stages : y sont admises des personnes de plus de cinquante ans, ou bien des malades en phase terminale. (…) Il est troublant de voir se presser cette foule de femmes et d’hommes, à la recherche d’un moyen de sortie. (…) Ils paraissent tous accablés par ces corps dont il faut, d’une manière ou d’une autre, se défaire. Il faudrait une poubelle ad hoc. Des images de déchets me viennent à l’esprit, peut-être parce que, en excluant tout à fait le genre humain de la chaîne alimentaire, en le mettant hors d’atteinte des dangereux appétits d’autres espèces, tout au moins les espèces visibles à l’œil nu, on a transformé la masse des individus en corps à éliminer. (67)
Hier est arrivé le livre de nouvelles d’un ami par qui, à un moment donné, je m’étais sentie blessée. Je me suis rappelé, en lisant et en reconnaissant dans la femme à la jupe légère et aux sandales en caoutchouc sa propre femme, à quel point je les avais aimés, tous les deux. Et j’ai eu l’impression d’éprouver de nouveau cet amour. Et si on me l’a mal rendu, quelle importance ? Maintenant, je suis au-delà de tels calculs, peu importe si l’amour est raisonnablement dirigé ou pas. Je ne juge plus mes sentiments. C’est une énergie, rien d’autre, l’amour; il coule comme il veut; si l’on se demande qui mérite d’être aimé et qui ne le mérite pas, on le bloque. (137)
Certaines personnes guérissent bel et bien, sous l’influence de la foi. Par pure crédulité. Par autopersuasion. Moi, je n’y arrive pas. Je ne parviens pas à croire comme un petit enfant à qui on raconte des histoires de Père Noël. Voudrais-je en être capable ? Je n’en sais rien. Mon amour de la vérité est trop grand pour être troqué contre le gain de la guérison. (146)
J’avais cette idée : vivre la paix et la sérénité, en m’affranchissant du désir de vouloir toujours plus, d’avoir envie de tout. C’était un idéal de frugalité, d’opposition à l’avidité dominante. (…) Cette aspiration continue à me sembler digne. Si elle vacille, c’est que, face à la peur, à la palpabilité de la notion imminente de n’être plus, l’âme est agressée par les fantasmes, les tentations, les doutes. La dissolution concerne, outre le corps, la pensée, la foi et la force d’âme. Heureusement j’ai su, ne serait-ce qu’un peu, être assez disciplinée pour méditer, heureusement je suis, ne serait-ce qu’un peu, allée à contre-courant : ainsi, même dans la tempête, même quand mes énergies s’effondrent, il n’est pas exclu que je puisse trouver un point d’appui, fût-il minuscule, peu importe. (220)