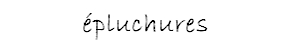Il est émouvant de découvrir un livre d’entretiens (arrangés, réécrits) de cet écrivain que j’imaginais farouche. Jean Carrière s’y livre avec franchise et dévoile des larges parts de son intimité.
Il revient sur son enfance marquée par la musique, qui ouvrit très tôt chez lui de vastes espaces intérieurs. Ils lui insufflent la vocation d’écrire et de courir les collines à la recherche d’autre chose.
J’avais pris la mesure de ma vraie vie. (708)
Un goût effronté et total de l’existence en soi.
L’homme des bois questionne la vie dans son essence, cherche le lien entre l’homme et l’insaisissable, le point de non-départ. Il y a une grande cohérence entre son être et ses écrits. L’homme est intègre, a toujours évolué en dehors des carcans. Il a porté sa sensibilité à fleur de peau dans le monde avec douleur et flamboyance. Et ce n’est pas une mince affaire que de porter son intégrité à bout de bras dans un monde qui ne valorise guère ce genre de démarche. Comment naviguer entre naissance et mort tout en restant un être humain à part entière ?
C’est précisément à partir de la mort que tout reste à dire sur la vie. (857)
J’ai retrouvé la trace des romans que j’ai aimés : la combe, la caverne sont évoqués. Il vaut mieux avoir lu Retour à Uzès et L’épervier de Maheux pour vraiment apprécier l’entièreté de l’ouvrage. Sa démarche d’écrivain se dévoile. La naissance d’une métaphysique des grands espaces. Il a finit par donner naissance à une littérature qui reflète la réalité extérieure à l’homme, les pierres, le vent, cette matière qu’il respectait tant chez Jean Giono.
Dense, riche, un concentré de force.
Le roman est là pour prendre le relais, et fournir à notre état civil les violences, les péripéties, les démesures qui lui conviennent et qui sont finalement les siennes, mais irréalisées, à l’état d’ébauche. En transposant nos balbutiements dans le définitif, l’achevé, la réalisé, le roman donne à notre destin les dimensions et la densité que la vie lui refuse, et il devient un acte de notre vie, il s’incorpore à notre vie, il ne nous délivre de rien, il nous prend en charge là où nous ne sommes plus capables de le faire nous-mêmes. (765)
Cette ascèse de la création consiste en effet à moins dévorer le monde qu’à l’adorer. A en jouir au second degré. L’expérience de l’écriture montre à quel point une certaine satiété, ou satisfaction immédiate des besoins, peut être néfaste à ce don merveilleux de pouvoir parler des choses tout en y renonçant, et peut-être grâce à ce renoncement. Il est également vrai que l’artiste parle encore mieux de ce qui lui manque que de ce qu’il possède. (800)