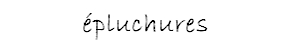Plateau du Lévézou, puech Monseigne
La langue navajo compte quatre-vingts mots pour exprimer toutes les nuances de couleur et de texture du grès. (160)
Voilà qui va permettre de renouveler la fameuse répartie sur les inuits et leur cinquantaine de mots pour désigner la neige !
En pays Navajo, les routes sont rectilignes sur des kilomètres, comme une invitation lancinante à la découverte. On pressent qu’elles n’ont de fin qu’au bout du monde. Peut-être leur seule fonction est-elle d’inciter le voyageur à avancer jusqu’à oublier qu’il a un but, s’il a un but. L’asphalte se fait parfois tortueux, il se perd en méandres qui escaladent montagnes et mesas pour mieux ramener le promeneur à la platitude du plateau désertique. (40)
Christophe Magny a un parcours touchant. En quête de sens, se demandant ce qu’il fait sur terre, il tente de s’inspirer de diverses traditions pour nourrir son voyage intérieur. Les voies de guérison navajos, découvertes à Paris lors d’une manifestation culturelle, vont représenter pour lui une expérience vivante et équilibrante, un tissus de liens amicaux et chaleureux – malheureusement momentanés car il a volontairement mis fin à ses jours quelques années plus tard. Savoir que son aspiration spirituelle ne s’est pas épanouie vers l’apaisement de ses abîmes intimes rend la lecture de son livre à la fois triste et intense.
Le but de la méditation et de la prière n’est pas l’expansion de la conscience mais la concentration sur le centre, le récepteur. C’est, me semble-t-il, ce qu’exprime hozhoo pour les Navajos : la nécessité de maintenir cette réceptivité, qui passe par une quête de l’harmonie avec les forces élémentaires. (70)
Immergé dans la beauté du crépuscule, je parviens sans y penser à formuler simplement l’idée de l’énergie et du récepteur : plus on capte la beauté, plus on s’emplit de beauté ; plus on s’emplit de beauté, mieux on capte la beauté. (123)
Avec lui, on pénètre et on s’assoit sous le hogan, au centre. Dans ce pays d’horizon, de lumière et de neige où les paysages se modifient selon l’heure et le temps, les pistes sont incertaines, les chemins sans indications, les conduites nocturnes à faire frissonner. La collision avec une vache ou un cheval est toujours possible. L’égarement encore plus. Se fiant à ses liens fraternels et à ses soutiens, tentant l’immersion à l’aide de ses seules intuitions et capacités à sentir, évacuant la raison, l’auteur s’en sort plutôt bien. Il prend naturellement le pli de parler en termes d’est, de sud, d’ouest et de nord, comme dans les romans de Tony Hillerman. Trouve les lieux de cérémonie. Laisse la beauté l’emplir et accomplit les gestes de bénédiction. Il revient de ses voyages l’âme unie au corps, ayant retrouvé le sentiment de savoir où il se trouve.
En lui confiant mon sentiment persistant de n’être pas parti, je m’interroge : cette évaporation des mois passés n’est-elle pas le signe de mon adhésion à la conception navajo du temps ? Ce qui compte, c’est de se retrouver, pas de mesurer le temps évanoui depuis la dernière rencontre. Puisque nous sommes réunis, nous n’avons jamais été séparés. (172)

Puech Monseigne

Coccinelles

Coccinelles

Faucon crécerelle

Faucons crécerelles

Plateau du Lévézou – Puech Monseigne

Plateau du Lévézou – Puech Monseigne
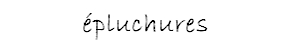
Il ne faut pas se plaindre du temps. Si l’on dit « J’en ai assez qu’il pleuve », on insulte la pluie, puissance considérable.On s’expose à la maladie. Celle-ci survient si l’on manque de respect à un élément, ou un animal, ou quoi que ce soit de respectable. Le rôle du diagnostiqueur est d’identifier la puissance offensée afin que l’homme médecine sache auprès de qui il doit intercéder pour obtenir la guérison. (16)
Elle se poste enfin devant la porte, nous tournant le dos, et se bénit d’une pincée de pollen sur la langue, une sur le front, et une jetée devant elle, vers l’est, pour la Terre-mère. (36)
Depuis mon entrée dans la Réserve, la lenteur dans les gestes, les paroles, l’écoute, les réactions des Navajos ne cesse de me frapper. J’ai pu le constater dès l’adolescence lors de mes premières incursions hors d’Europe : le temps des Blancs ne règne pas partout, le tempo peut décroître jusqu’à la langueur extrême des climats accablants, le rythme passer du binaire simple des Européens – réflexion, action – au ternaire complexe – réflexion, pause, action éventuelle – des cultures lentes, qui savent depuis des millénaires que les choses ne se font ni mieux ni plus vite en courant qu’en marchant, qui ne sont même pas sûres que faire soit une fin en soi. (41)
De l’un des multiples meubles qui peuplent le hogan, Rainbow sort une bourse de daim. Elle en tire une chaîne d’argent au bout de laquelle se balance un objet de turquoise finement sculpté, à l’aspect ancien. C’est un horned toad, un crapaud à cornes, influent animal que créèrent les Êtres sacrés pour les aider à venir à bout d’un peuple de monstres. Elle l’approche de mes lèvres et m’indique comment je dois inspirer, trois fois doucement, une fois profondément la bouche du crapaud devant la mienne. Je me place ainsi sous sa protection, et appartiens désormais à la famille des crapauds à cornes. Si j’en croise un, je dois le saluer, le prendre dans ma main, le caresser. Celui que je porte est Chei, grand-père. Pour invoquer son aide il me suffit de le frotter contre ma poitrine. (45)
J’essaie de mettre en pratique une des bases de la philosophie navajo que m’a enseignée Roger : ce qui est dit est dit, ce qui est fait est fait, l’offenseur comme l’offensé doivent en assumer les conséquences. Il ne sert à rien de s’excuser, encore moins d’avoir des regrets. (65)
Ici se tient la réalité telle que je n’osais la rêver, éclatante de simplicité. Ici on peut être humain, les seuls à porter des masques sont les danseurs de Yeibichei. Jamais je n’ai éprouvé le besoin de jouer un rôle, je me tiens au plus près de moi, à la limite du lit du vent – aucun autre choix n’est offert. (127)
Il me tend une cigarette : « Tu vas souffler la fumée vers la Terre, qui est ta mère. Vers le Ciel, qui est ton père. Vers le Soleil et la Lune, qui sont ton oncle et ta tante. Vers l’est, d’où vient la lumière, pour t’assurer la protection du Peuple-serpent. Vers le sud, d’où vient la chaleur, pour t’assurer la protection du Peuple-éclair. Vers l’ouest, d’où vient l’obscurité, pour t’assurer la protection du Peuple-coyote. Vers le nord, d’où vient le froid, pour t’assurer la protection du Peuple-ours. Tu souffleras la fumée ici – il montre son attaché-case – pour t’assurer la protection de mes instruments. Tu souffleras la fumée sur toi, des pieds à la tête, pour que ces bénédictions t’accompagnent. » (187)